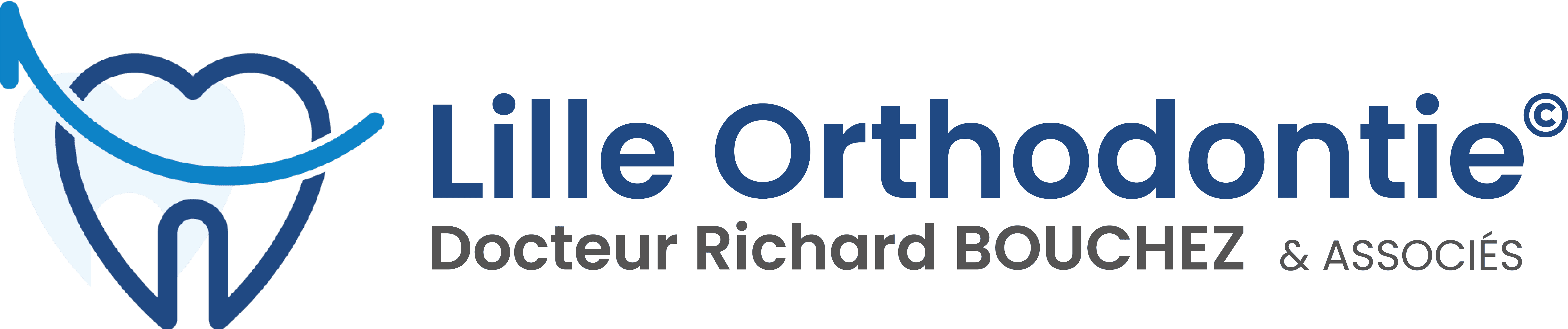Infarctus du myocarde : les bêtabloquants entre confirmation et remise en question
12 sept. 2025
12 sept. 2025
12 sept. 2025

Cardiologie
Infarctus du myocarde : les bêtabloquants entre confirmation et remise en question
Deux grands essais présentés à l'ESC 2025 aboutissent à des conclusions divergentes chez les patients post-infarctus avec FEVG ≥40 % : bénéfice modeste dans BETAMI–DANBLOCK, absence d’effet dans REBOOT. La décision de prescrire au long cours devrait être individualisée selon le profil ischémique, la FEVG et le contexte de revascularisation.
Historiquement, les bêtabloquants réduisaient mortalité et récidive d’infarctus, sur la base d’essais anciens conduits avant la reperfusion systématique. Leur bénéfice reste indiscutable quand la FEVG ≤40 %. L’incertitude persiste pour les FEVG préservées ou légèrement réduites (≥40 %). Deux essais récents, de conception proche mais de résultats contrastés, réévaluent cette indication.
BETAMI–DANBLOCK (Norvège/Danemark) a randomisé 5 574 patients dans les 14 jours post-événement, FEVG ≥40 %, bêtabloquant vs absence de bêtabloquant ; après 3,5 ans, le critère principal composite (décès, nouvel infarctus, revascularisation non planifiée, AVC ischémique, insuffisance cardiaque, arythmies ventriculaires malignes) est réduit sous bêtabloquant : 14,2 % vs 16,3 % (HR 0,85 ; IC à 95 % 0,75–0,98 ; p=0,03), avec moins de récidives d’infarctus (5,0 % vs 6,7 % ; HR 0,73). À l’inverse, REBOOT (Espagne/Italie) a inclus 8 438 patients sortant d’une prise en charge invasive, FEVG >40 %, et ne montre aucun effet sur le critère composite décès, ré-infarctus ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque après 3,7 ans (HR 1,04 ; IC à 95 % 0,89–1,22), ni sur ses composantes.
De l’ère pré-reperfusion à l’angioplastie moderne : que reste-t-il du dogme ?
Dans BETAMI–DANBLOCK, la réduction du risque est surtout portée par la baisse des ré-infarctus, sans différence pour la mortalité toutes causes (4,2 % vs 4,4 %), l’IC, l’AVC ou les arythmies ventriculaires malignes ; la tolérance est comparable entre groupes malgré des doses modestes (métoprolol LP médiane 50 mg) et un crossover proche de 11 %. Le bénéfice semble plus marqué lorsque la FEVG est « légèrement réduite » (41–49 %; HR 0,82 ; IC à 95 % 0,65–1,02, analyse exploratoire).
REBOOT, avec adjudication centrale en aveugle et stratégie pragmatique (bêtabloquant au choix, doses libres), ne retrouve pas d’effet, y compris en analyses de sous-groupes ; des signaux exploratoires d’inefficacité chez les femmes et les STEMI demandent confirmation. Les profils de sécurité sont superposables.
La cohérence de REBOOT avec REDUCE-AMI (FEVG ≥50 %) et CAPITAL-RCT renforce l’hypothèse qu’en population largement revascularisée, sous DAPT et statines, l’effet des bêtabloquants s’atténue lorsque la fonction systolique est conservée.
Vers une prescription ciblée ?
Ces essais partagent un design ouvert avec évaluation des événements en aveugle, mais diffèrent par le calendrier d’initiation (≤14 jours dans BETAMI–DANBLOCK vs à la sortie dans REBOOT), la distribution des FEVG (inclusion systématique des FEVG 40–49 % dans BETAMI–DANBLOCK, plus restreinte dans REBOOT) et l’intensité thérapeutique contemporaine. Le bénéfice modeste observé dans BETAMI–DANBLOCK, dominé par la réduction des ré-infarctus non STEMI, suggère qu’un sous-ensemble (FEVG 40–49 %, charge ischémique résiduelle, fréquence cardiaque élevée, angor) pourrait tirer avantage d’un bêtabloquant au long cours. À l’opposé, chez les patients entièrement revascularisés, FEVG ≥50 %, stables et optimisés, REBOOT soutient une stratégie d’abstention sans perte de chance.
Selon les auteurs, il paraît raisonnable de : maintenir une indication forte lorsque la FEVG ≤40 % ; considérer les bêtabloquants chez les FEVG 40–49 % ou en présence de symptômes/ischémie documentée ; réévaluer systématiquement la poursuite au-delà de 6–12 mois chez les FEVG ≥50 % stables, surtout si bradycardie, hypotension ou intolérance.
Les priorités de recherche incluent une méta-analyse sur données individuelles combinant BETAMI–DANBLOCK, REBOOT et REDUCE-AMI pour identifier les phénotypes répondeurs, la comparaison par classes/doses, et la durée optimale de traitement. En attendant, la prescription doit être individualisée, partagée avec le patient, et révisée au fil du temps à l’aune du rapport bénéfice–risque et des objectifs de fréquence/angor.
Cardiologie
Infarctus du myocarde : les bêtabloquants entre confirmation et remise en question
Deux grands essais présentés à l'ESC 2025 aboutissent à des conclusions divergentes chez les patients post-infarctus avec FEVG ≥40 % : bénéfice modeste dans BETAMI–DANBLOCK, absence d’effet dans REBOOT. La décision de prescrire au long cours devrait être individualisée selon le profil ischémique, la FEVG et le contexte de revascularisation.
Historiquement, les bêtabloquants réduisaient mortalité et récidive d’infarctus, sur la base d’essais anciens conduits avant la reperfusion systématique. Leur bénéfice reste indiscutable quand la FEVG ≤40 %. L’incertitude persiste pour les FEVG préservées ou légèrement réduites (≥40 %). Deux essais récents, de conception proche mais de résultats contrastés, réévaluent cette indication.
BETAMI–DANBLOCK (Norvège/Danemark) a randomisé 5 574 patients dans les 14 jours post-événement, FEVG ≥40 %, bêtabloquant vs absence de bêtabloquant ; après 3,5 ans, le critère principal composite (décès, nouvel infarctus, revascularisation non planifiée, AVC ischémique, insuffisance cardiaque, arythmies ventriculaires malignes) est réduit sous bêtabloquant : 14,2 % vs 16,3 % (HR 0,85 ; IC à 95 % 0,75–0,98 ; p=0,03), avec moins de récidives d’infarctus (5,0 % vs 6,7 % ; HR 0,73). À l’inverse, REBOOT (Espagne/Italie) a inclus 8 438 patients sortant d’une prise en charge invasive, FEVG >40 %, et ne montre aucun effet sur le critère composite décès, ré-infarctus ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque après 3,7 ans (HR 1,04 ; IC à 95 % 0,89–1,22), ni sur ses composantes.
De l’ère pré-reperfusion à l’angioplastie moderne : que reste-t-il du dogme ?
Dans BETAMI–DANBLOCK, la réduction du risque est surtout portée par la baisse des ré-infarctus, sans différence pour la mortalité toutes causes (4,2 % vs 4,4 %), l’IC, l’AVC ou les arythmies ventriculaires malignes ; la tolérance est comparable entre groupes malgré des doses modestes (métoprolol LP médiane 50 mg) et un crossover proche de 11 %. Le bénéfice semble plus marqué lorsque la FEVG est « légèrement réduite » (41–49 %; HR 0,82 ; IC à 95 % 0,65–1,02, analyse exploratoire).
REBOOT, avec adjudication centrale en aveugle et stratégie pragmatique (bêtabloquant au choix, doses libres), ne retrouve pas d’effet, y compris en analyses de sous-groupes ; des signaux exploratoires d’inefficacité chez les femmes et les STEMI demandent confirmation. Les profils de sécurité sont superposables.
La cohérence de REBOOT avec REDUCE-AMI (FEVG ≥50 %) et CAPITAL-RCT renforce l’hypothèse qu’en population largement revascularisée, sous DAPT et statines, l’effet des bêtabloquants s’atténue lorsque la fonction systolique est conservée.
Vers une prescription ciblée ?
Ces essais partagent un design ouvert avec évaluation des événements en aveugle, mais diffèrent par le calendrier d’initiation (≤14 jours dans BETAMI–DANBLOCK vs à la sortie dans REBOOT), la distribution des FEVG (inclusion systématique des FEVG 40–49 % dans BETAMI–DANBLOCK, plus restreinte dans REBOOT) et l’intensité thérapeutique contemporaine. Le bénéfice modeste observé dans BETAMI–DANBLOCK, dominé par la réduction des ré-infarctus non STEMI, suggère qu’un sous-ensemble (FEVG 40–49 %, charge ischémique résiduelle, fréquence cardiaque élevée, angor) pourrait tirer avantage d’un bêtabloquant au long cours. À l’opposé, chez les patients entièrement revascularisés, FEVG ≥50 %, stables et optimisés, REBOOT soutient une stratégie d’abstention sans perte de chance.
Selon les auteurs, il paraît raisonnable de : maintenir une indication forte lorsque la FEVG ≤40 % ; considérer les bêtabloquants chez les FEVG 40–49 % ou en présence de symptômes/ischémie documentée ; réévaluer systématiquement la poursuite au-delà de 6–12 mois chez les FEVG ≥50 % stables, surtout si bradycardie, hypotension ou intolérance.
Les priorités de recherche incluent une méta-analyse sur données individuelles combinant BETAMI–DANBLOCK, REBOOT et REDUCE-AMI pour identifier les phénotypes répondeurs, la comparaison par classes/doses, et la durée optimale de traitement. En attendant, la prescription doit être individualisée, partagée avec le patient, et révisée au fil du temps à l’aune du rapport bénéfice–risque et des objectifs de fréquence/angor.
Cardiologie
Infarctus du myocarde : les bêtabloquants entre confirmation et remise en question
Deux grands essais présentés à l'ESC 2025 aboutissent à des conclusions divergentes chez les patients post-infarctus avec FEVG ≥40 % : bénéfice modeste dans BETAMI–DANBLOCK, absence d’effet dans REBOOT. La décision de prescrire au long cours devrait être individualisée selon le profil ischémique, la FEVG et le contexte de revascularisation.
Historiquement, les bêtabloquants réduisaient mortalité et récidive d’infarctus, sur la base d’essais anciens conduits avant la reperfusion systématique. Leur bénéfice reste indiscutable quand la FEVG ≤40 %. L’incertitude persiste pour les FEVG préservées ou légèrement réduites (≥40 %). Deux essais récents, de conception proche mais de résultats contrastés, réévaluent cette indication.
BETAMI–DANBLOCK (Norvège/Danemark) a randomisé 5 574 patients dans les 14 jours post-événement, FEVG ≥40 %, bêtabloquant vs absence de bêtabloquant ; après 3,5 ans, le critère principal composite (décès, nouvel infarctus, revascularisation non planifiée, AVC ischémique, insuffisance cardiaque, arythmies ventriculaires malignes) est réduit sous bêtabloquant : 14,2 % vs 16,3 % (HR 0,85 ; IC à 95 % 0,75–0,98 ; p=0,03), avec moins de récidives d’infarctus (5,0 % vs 6,7 % ; HR 0,73). À l’inverse, REBOOT (Espagne/Italie) a inclus 8 438 patients sortant d’une prise en charge invasive, FEVG >40 %, et ne montre aucun effet sur le critère composite décès, ré-infarctus ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque après 3,7 ans (HR 1,04 ; IC à 95 % 0,89–1,22), ni sur ses composantes.
De l’ère pré-reperfusion à l’angioplastie moderne : que reste-t-il du dogme ?
Dans BETAMI–DANBLOCK, la réduction du risque est surtout portée par la baisse des ré-infarctus, sans différence pour la mortalité toutes causes (4,2 % vs 4,4 %), l’IC, l’AVC ou les arythmies ventriculaires malignes ; la tolérance est comparable entre groupes malgré des doses modestes (métoprolol LP médiane 50 mg) et un crossover proche de 11 %. Le bénéfice semble plus marqué lorsque la FEVG est « légèrement réduite » (41–49 %; HR 0,82 ; IC à 95 % 0,65–1,02, analyse exploratoire).
REBOOT, avec adjudication centrale en aveugle et stratégie pragmatique (bêtabloquant au choix, doses libres), ne retrouve pas d’effet, y compris en analyses de sous-groupes ; des signaux exploratoires d’inefficacité chez les femmes et les STEMI demandent confirmation. Les profils de sécurité sont superposables.
La cohérence de REBOOT avec REDUCE-AMI (FEVG ≥50 %) et CAPITAL-RCT renforce l’hypothèse qu’en population largement revascularisée, sous DAPT et statines, l’effet des bêtabloquants s’atténue lorsque la fonction systolique est conservée.
Vers une prescription ciblée ?
Ces essais partagent un design ouvert avec évaluation des événements en aveugle, mais diffèrent par le calendrier d’initiation (≤14 jours dans BETAMI–DANBLOCK vs à la sortie dans REBOOT), la distribution des FEVG (inclusion systématique des FEVG 40–49 % dans BETAMI–DANBLOCK, plus restreinte dans REBOOT) et l’intensité thérapeutique contemporaine. Le bénéfice modeste observé dans BETAMI–DANBLOCK, dominé par la réduction des ré-infarctus non STEMI, suggère qu’un sous-ensemble (FEVG 40–49 %, charge ischémique résiduelle, fréquence cardiaque élevée, angor) pourrait tirer avantage d’un bêtabloquant au long cours. À l’opposé, chez les patients entièrement revascularisés, FEVG ≥50 %, stables et optimisés, REBOOT soutient une stratégie d’abstention sans perte de chance.
Selon les auteurs, il paraît raisonnable de : maintenir une indication forte lorsque la FEVG ≤40 % ; considérer les bêtabloquants chez les FEVG 40–49 % ou en présence de symptômes/ischémie documentée ; réévaluer systématiquement la poursuite au-delà de 6–12 mois chez les FEVG ≥50 % stables, surtout si bradycardie, hypotension ou intolérance.
Les priorités de recherche incluent une méta-analyse sur données individuelles combinant BETAMI–DANBLOCK, REBOOT et REDUCE-AMI pour identifier les phénotypes répondeurs, la comparaison par classes/doses, et la durée optimale de traitement. En attendant, la prescription doit être individualisée, partagée avec le patient, et révisée au fil du temps à l’aune du rapport bénéfice–risque et des objectifs de fréquence/angor.